|
Au début des années 50, les
autorités Françaises avaient mesuré le caractère indispensable de posséder
une force de frappe dissuasive autonome. En 1951, le gouvernement
Bourgès-Maunoury se prononça en faveur des missiles stratégiques. Puis en
1954, c'est Pierre Mendès France qui lance le programme atomique Français
militaire. Le refus des deux grands a renoncer à la course au armement
avait fait pencher la décision de la France pour une force
dissuasive.
En 1958, le général de Gaule arrive à l'Élysée et sur la
lancé de ses prédécesseurs lance la création d'un organisme qui sera la
clef de voûte de l'aventure spatiale la SEREB, Société pour l'Étude et
la Réalisation d'Engins Balistiques. Devant le refus de coopération avec
Boeing et Lockheed, la jeune société se met en quête de développer ses
propres missiles.
Financée à l'origine par le
ministère de la défense, la SEREB va resté jusqu'en 1970 avant la fusion
avec Nord et Sud Aviation pour créer l'Aérospatiale, le fer de lance de
la réflexion française en matière balistique. Outre les programmes de
missiles sol-sol et sol-mer, elle explorera les avantages et les
inconvénients de la propulsion liquide et à poudre, tout en améliorant les
techniques de guidage et de pilotage des lanceurs. Travaillant dans un
premier temps pour le militaire et et en "cachette " pour le spatial, la
SEREB "officialise" son activité spatiale en 1961.
Quand le général de Gaule
décidera de quitter l'OTAN en 1964, la SEREB sera obligée de développer
toute seule de nouveaux missiles ainsi que leur système de guidage
auparavant fournit sous licence par les Américains.
Septembre 1961, la France
décide de réaliser un lanceur spatial. Dans ce but, la SEREB avait
développé des véhicules d'essai dits VE qui portaient un numéro à trois
chiffres, le premier indiquant le nombre d'étages, le second le mode de
propulsion à poudre ou liquide et le dernier la présence ou non d'un
système de guidage. A ces véhicules des noms de pierres précieuses ont été
donné, Agate, Topaze, Rubis, Émeraude et
Saphir.
|
 |
NOM: Agate VE
110
HAUTEUR: 8,56 m
DIAMETRE:
MASSE: 3400
kg
CHARGES: 100 kg à 200 km
1er vol : juin
1961.
Successeur du VE Aigle, il expérimente
la mise au point d'une ogive de mesures qui doit être montée sur
tous les véhicules d'essai suivant, d'une case à équipement
récupérable et des moyens d'essais et de mise en oeuvre du champ de
tir d'Hammaguir. 8 tirs sont réalisés entre 1961 et 63 avec succès.
Les quatre autres tirs suivants en version 110RR verront trois
échecs en 1963-64. |
|
 |
NOM: Topaze VE
111
HAUTEUR:
DIAMETRE:
MASSE:
CHARGES:
1er
vol : décembre 1962
Topaze est la première
fusée à poudre française pilotée, grâce à quatre tuyères orientables
monté sur le fond du propulseur à poudre. Elle est stabilisée
aérodynamiquement non plus par des empennages, mais par une jupe,
sorte de tronc de cône, dont la traînée la maintient sur sa
trajectoire. Elle s'est rendu célèbre le 19 novembre 1962 en
expérimentant pour la première fois le système de pilotage
automatique. Elle est lancée au total 14 fois dont 13 avec succès
jusqu'en mai 1965. Les résultats très satisfaisants obtenus avec
les VE-110 Agate et VE-111 Topaze permettent de passer à la phase
suivante, celle de la validation du premier étage du VE-231
Saphir. |
|
 |
NOM: Rubis VE
210
HAUTEUR: 9,61 m
DIAMETRE:
MASSE: 3360
kg
CHARGES: 30 kg à 2000 km
1er vol : juin 1964.
Le VE 210 réalise 6 tirs d'Hammaguir
avec Agate comme premier étage, Turquoise comme second pour étudier
le troisième du lanceur Diamant (largage de la coiffe, la séparation
et la mise en rotation).
4 autres tirs en version Rubis fusée ont
lieu en 1965-67 pour des expériences scientifiques. |
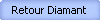
|
 |
Le premier étage à
ergols liquide Émeraude VE 121 permet d'étudier la propulsion
(moteur Vexin). 5 sont lancé entre juin 1964 et juillet 1965. Le 15
juin 1964, le premier véhicule expérimental Émeraude VE-121 numéro 1
échoue suite à un problème de guidage. Le lancement a lieu depuis
depuis Hammaguir près de Colomb-Béchar en Algérie. La réalisation
d'un premier étage à propulsion par propergols liquide pour le
VE-231 Saphir s'impose. D'autant plus que le LRBA a déjà réalisé un
moteur de 16 tonnes de poussée pour la fusée sonde Vesta et qu'une
extrapolation des possibilités de ce moteur à 25 tonnes est
envisageable à court terme. La technologie des propergols solide
n'étant pas suffisamment développée pour permettre des poussées aussi
importante, le VE-121 Émeraude doit donc permettre l'étude de la
propulsion à partir de propergols liquide.
Le VE-121 servira de
premier étage au VE-231 Saphir. Il mesure 17,93 mètres, pour un
diamètre de 140 centimètres. Le moteur est alimenté en ergols par
pressurisation des réservoirs et fonctionne avec 12,7 tonnes d'acide
nitrique et d'essence de térébenthine, il développe une poussée de
280 KN pendant 91 secondes. La charge utile est de 395 Kg pour une
altitude maximum de 200 Km. Sa masse est de 18,2 tonnes.
Le
VE-121 est stabilisé aérodynamiquement par quatre empennages en
croix. Le pilotage en tangage et en lacet est assuré par la tuyère
orientable. Le pilotage en roulis par des gouvernes de bord de fuite
montées sur deux des quatre empennages et assistées de deux
propulseurs auxiliaires à poudre.
Le VE-121 est constitué d'un
premier étage à propulsion liquide, d'un second étage inerte
simulant la masse et dimensions du futur VE-231 Saphir et d'une tête
de mesure.
Sur les 5 tirs réalisés, les trois
premiers échoueront. |





Topaze VE 111 apporte des
solutions aux problèmes de la mobilité des tuyères pour le pilotage en
déviant le jet des moteurs. Placé sur Émeraude, il devient Saphir VE 231.
Dans le programme militaire initial, la fusée VE-231 Saphir doit permettre
d'expérimenter les techniques de pilotages, de séparation entre le premier
et le deuxième étage, de guidage et de rentrée dans l'atmosphère de la
tête de mesure. Trois tirs sont réalisé entre juillet et octobre 1965 avec
un échec (second tir).
Le but de la version VE-231G lancé 6 fois
en mars 1966 (tir G1-G2), en novembre 1966 (tir G3-G4) et janvier 1967
(tir G5-G6) est de permettre la mise au point d'un système de
guidage inertiel composé d'une centrale et d'un calculateur, de valider le
bon fonctionnement du système d'arrêt de poussée et de parfaire les études
de la précision de guidage.
Le but de la version VE-231 R lancé 5 fois
en 1966 est de permettre l'étude des problèmes liés à la rentrées dans
l'atmosphère et en particulier celle de l'ablation des matériaux du corps
de rentrée.
15 fusées sont lancées de juillet 1965 à janvier 1967 avec
seulement deux échecs (second et 12eme tirs).
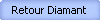


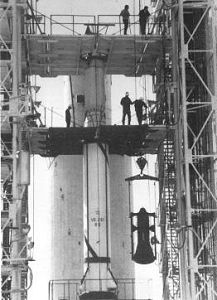
La SEREB pense qu'en
associant à Saphir un 3eme étage on pourrait créer un lanceur de
satellites capable de satelliser 50 à 80 kg à 200 km. Cet étage
entièrement nouveau avec une structure en fibre de verre bobonés et à
poudre, il fallait le créer.
Le premier Diamant est lancé
le 26 novembre 1965 avec dans sa coiffe A1, une capsule technologique de
47 kg témoin de la réussite française. Malheureusement la presse ne
fut pas le témoin de l'exploit, la peur d'un échec à la veille des
élections présidentielles ayant inquiété l'Élysée et "militarisé" l'évènement.
Quatre Diamant sont lancés
d'Hammaguir. La seconde le 17 février 1966 pour satelliser Diapason, la
troisième et quatrième les 8 et 15 février 1967 pour lancer Diadem 1 et
2.
Hammaguir ferme ses portes le 1er juillet suivant et il faudra
attendre trois ans avant qu'une Diamant B ne lance le satellite Allemand Dial de la base équatoriale de Kourou, en Guyane.
|