|
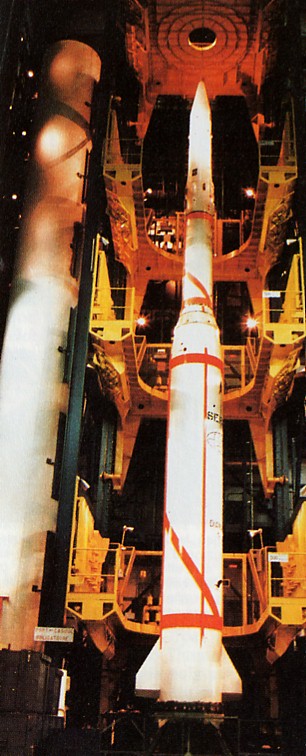 |
Lorsque né le CNES, l'agence spatiale Française en
1961 et après sa prise de fonction en mars 1962, les ingénieurs font un
rapide état de ce qu'il existe comme fusées, moteurs et de ce qui
pourrait exister selon les crédits disponibles. Mis à part les fusées
sondes, il n'existe pas vraiment de projet de lanceur spatial, à par un
missile militaire qui pourrait servir de lanceur.
Un accord est signé
entre la Délégation Ministérielle de l'Armement DMA et le CNES pour
réaliser une version spatiale du Saphir en décembre 1961. la maîtrise d'oeuvre est confié à la SEREB, la société d'études et de réalisation d'engins balistiques.
La fusée
Rubis est alors créée pour tester en vol le troisième étage du lanceur,
monté pour la circonstance sur un étage Agate.
Diamant A est un lanceur trois étages mesurant 18,2 m
de hauteur pour 1, 40 m de diamètre. Il pèse 18,39 tonnes au
lancement.
Le premier étage Émeraude mesure 9,92 m de hauteur et
pèse 14,71 tonnes au lancement. il contient 12,762 tonnes d'essence de
térébenthine et d'acide nitrique alimentant un moteur Vexin à tuyère
orientable de 28 tonnes de poussée. Sa durée de fonctionnement est de 93
secondes. Le moteur Vexin ne
comporte pas de turbopompe. Les liquides sont injectés dans la chambre de
combustion par mise en pression (22 bars) des réservoirs. Un générateur
à combustible solide dont les gaz sont refroidis par de l'eau assure cette
mise en pression. La tuyère est montée sur cardan. Son orientation est
commandée par deux vérins. Cette disposition permet de contrôler
l'assiette de la fusée en tangage et en lacet ; (le roulis est contrôlé
par des dispositifs installés sur deux des quatre stabilisateurs
aérodynamiques situés à l'arrière de la fusée). Le moteur VEXIN a équipé
Émeraude, Saphir puis Diamant. |
|
 |
 |
| Jupe 1er/2ème étages |
Moteur Vexin |
|
 |
 |
| Essais d'un moteur Vexin |
Explosion lors d'un essai |
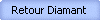
|
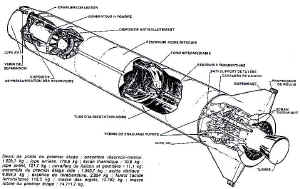 |
Diamètre
Longueur
Masse à
vide
Structure
Épaisseur de la virole
cylindrique
Nature des ergols acide nitrique + essence de
térébenthine
Masse d'acide après remplissage
Masse
d'essence après remplissage Diamètre du col de la
tuyère
Rapport de section
lmpulsion spécifique au
sol dans les conditions de fonctionnement
Durée de
combustion
Poussée au départ
Poussée moyenne |
1,4 m
10 m
1
950 kg
acier 15 CDV 6
2,3 mm
9700 kg
3070 kg
390
mm
3,6
203 sec.
93 s
274
kN
310 kN |
|
Le premier étage est constitué par une
enveloppe en acier soudé (Vascojet 90) divisée en deux réservoirs
par un diaphragme. L'éjecteur du moteur-fusée, articulé par un cardan,
permet de piloter l'étage en tangage et en lacet au moyen de deux
vérins à coupleur magnétique. Le pilotage en roulis résulte du
braquage de gouvernes aérodynamiques disposées sur deux des quatre
éléments d'empennage qui équipent la jupe arrière. La jupe
tronconique avant contient également certains équipements
séquentiels de pilotage et de mesures.
La mise à feu est
assurée par le mélange hypergolique de 113 kg de Fantol (déposé au
fond du réservoir d'essence) avec l'acide nitrique. La mise sous
pression (22 bars) des réservoirs s'effectue à l'aide d'un mélange
de gaz de poudres refroidies par de la vapeur d'eau issu d'un
générateur disposé sur le fond avant de l'engin. Ce générateur
contient 116 kg de poudre Epictéte E-8 et 120 litres d'eau. La
poussée varie entre 28 et 30 tonnes selon l'instant
considérée.
Ce premier étage est caractérisé par une grande
simplicité et une robustesse structurale remarquable étant donné
l'épaisseur des parois. Le système de chasse des ergols par
pressurisation, s'il conduit à une structure plus lourde, présentait
l'avantage d'être bien connu des techniciens du LRBA et fut donc
adopté par souci de simplicité et d'efficacité. Le choix du
classique système à turbopompes aurait évidemment permis d'abaisser
de 15 % à 9 % l'indice constructif de cet étage, mais au prix d'un
coût et d'une durée de mise au point nettement plus importants.
Quant à la pressurisation par gaz comprimé (hélium), encore plus
simple, elle aurait conduit à un bilan de masse difficile à accepter
d'autant plus que la pression de chambre aurait été encore
abaissée.
Tel qu'il est, ce premier étage Constitue donc un
compromis efficace entre le niveau de performance et le coût du
développement. On notera d'ailleurs que, dans le cas d'un premier
étage, les considérations économiques et industrielles doivent
l'emporter sur toutes autres; il peut en effet être plus rationnel
de réaliser, pour une énergie finale à fournir, un premier étage
plus gros et moins difficile à fabriquer. Une version à poudre de ce
premier étage fut envisagée par la suite avec ses quatre tuyères de
11 tonnes de poussée unitaire, elle aurait bénéficié des travaux
menés sur le deuxième étage, car sa conception était proche de celle
de Topaze. Avec une poussée au départ de 44 tonnes, Diamant aurait
alors bénéficié de performances meilleures (120 kg
satellisables). |
|
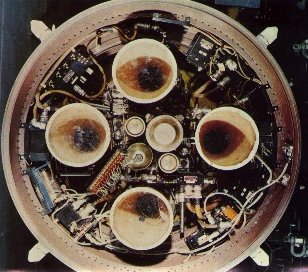 |
Le second étage Topaze est à poudre (Isolane). il
mesure 4,70 m de long pour 80 cm de diamètre. Il pèse 2,93 tonnes dont
2,26 de carburant. Quatre moteurs de 15 tonnes assurent la propulsion
pendant 44 secondes.
|
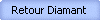
|
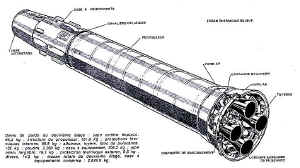 |
Diamètre
Longueur
Masse à
vide
Structure du propulseur
Épaisseur de la
virole cylindrique
Propergol
Masse de
poudre
Nombre de tuyères
Diamètre au col d'une
tuyère
Rapport de sections
Impulsion spécifique
dans le vide dans les conditions de fonctionnement
Durée de
combustion
Pression maximale de régime
Poussée moyenne |
800 mm
4,7
m
670 kg
acier 40 CDV 20
1.5
mm
lsolane 28/7
2260 kg
4
92
mm
12,2
259 s
44 s
35,2
bar
150 kN |
|
Le deuxième étage de Diamant Topaze (issu du
VE III) possède une structure en acier (roulé soudé) de 80 cm. de
diamètre, chargée d'un bloc de poudre lsolane élaboré par le Service
des Poudres. Les quatre tuyères mobiles sont orientables par
rotation elles sont en effet légèrement coudées, d'où une variation
de l'axe de poussée de chacune d'entre elle lorsqu'on les oblige à
tourner autour d'un axe perpendiculaire à leur embase. Des vérins
hydrauliques animent ces tuyères, ils sont alimentés en énergie par
un bloc de puissance disposé sur le fond arrière du propulseur. On
note, par ailleurs, pour la structure l'utilisation d'acier à haute
résistance (140/160 kg/mm2), type "Vascojet 1.000 ". et l'adoption
de tuyères en orthostrasyl.
Le propulseur est équipé d'un
allumeur, placé dans le fond avant, utilisant une composition
aluminothermique pulvérulente contenue dans un étui perforé.
La
jupe arrière tronconique du deuxième étage est aménagée pour
supporter le dispositif de basculement devant amener le troisième
étage à l'assiette convenable avant sa mise à feu. Le dispositif
pneumatique de basculement utilise un système de huit micro tuyères
fixes disposées à la périphérie de la jupe arrière.
La jupe, qui
relie le troisième étage à la case à équipements, est composée de
deux demi coquilles dont le déverrouillage puis l'ouverture grâce à
la force centrifuge assure le largage du troisième étage.
Les
équipements de pilotage sont tous situés dans dans la case à
équipement, à l'exception du bloc de puissance. Ces équipements
comprennent principalement une centrale d'attitude un bloc gyrométrique un bloc de commande un programmeur d'attitude un bloc
électronique de basculement.
La case contient
également les équipements de télécommande qui ont pour rôle de
transmettre l'ordre d'allumage anticipé du troisième étage ai une
correction de l'instant nominal est jugée nécessaire et de permettre
la destruction de l'engin ai celle-ci est commandée du sol pour des
raisons de sécurité. Elle contient aussi les équipements de
télémesure situés dans la case à équipements qui assurent la
transmission des informations provenant du premier étage, de la jupe
arrière deuxième étage et de la case elle-même.
Cette
télémesure est du type AJAX FM-FM.
Sur la structure externe de la
case à équipements sont enfin fixées quatre fusées de mise en
rotation à poudre et deux fusées de séparation à poudre (impulsion
totale de 2 800 N.s en 0.4 s
environ). |
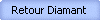
Le troisième étage P064 est aussi à poudre, il
mesure 1,85 m de long pour 65 cm de diamètre. il pèse 708 kg dont 640 de
carburant. Son moteur de 50 kg de poussé dans le vide fonctionne durant 44
secondes.
|
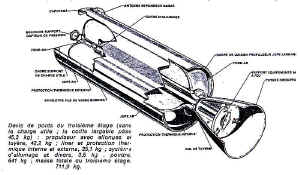 |
Diamètre
extérieur
Longueur
Masse à vide (allumeur
excepté)
Propergol
Masse de
poudre
impulsion spécifique dans le vide dans les
conditions de fonctionnement
Diamètre de col
Rapport de
sections
Pression initiale de
fonctionnement
Pression maximale
Durée de
combustion totale
Poussée maximale |
660 mm
2,06
m
67,9 kg
isolane 28/7
641 kg
273 s
96
mm
27,7
19 bars
40
bars
45s
52 kN |
|
L'enveloppe du 3 étage est obtenu par
bobinage sur un mandrin de fil de verre imprégné de résine phénolique. Les protections thermiques internes des fonds avant et
arrière sont mises en place sur le mandrin avant bobinage. Le
propulseur est recouvert extérieurement d'une protection thermique
sublimable et est équipé d'une tuyère fixe dont le divergent, en
orthostrasyl fretté par un bobinage on fil de verre, est formé
suivant un profil en - coquetier -.
L'allumeur est
constitué par une canne perforée contenant une charge
aluminothermique pulvérulente. Elle est solidaire d'un opercule fixé
en aval du col de la tuyère. La rupture de l'opercule 'à 'l'allumage
'du propulseur entraîne l'éjection de la canne et de la platine de
mise à feu. Les équipements de mise à feu sont constitués de deux
chaînes identiques en parallèle comportant principalement un
temporisateur commandé par un relais d'armement et un
accéléro-contact de sécurité. L'ordre d'armement est élaboré dans la
case à équipements par l'un des organes suivants le programmeur de
séquences. a chaîne de relais temporisés doublant ce dernier on
secours ou la télécommande selon les résultats de la
trajectographie.
La coiffe fixée sur la jupe avant du 3ème
étage assure la Continuité des formes aérodynamiques et protège la
charge utile pendant la traversée des couches denses de
l'atmosphère. Sa structure est constituée d'un stratifié verre -
résine en nid d'abeille. Elle est larguée en deux parties après
l'extinction du 2'étage. |
La coiffe recouvre cet étage. De forme conique
elle mesure 2,4 m de hauteur pour 45 kg.
Le Diamant peut placer 130 kg
sur une orbite basse à 200 km, inclinée à 5° ou 95 kg à 1000 km en orbite
polaire.
La
phase de vol commence par le décollage d'Hammaguir vers l'Est. Les deux
premiers étages fonctionnent durant 144 s, le premier retombant à 350 km
du pad dans le désert et le second à 1900 km en pleine mer.
Une phase
balistique suit la phase propulsée des étages inférieurs. Elle permet de
larguer la coiffe, puis de basculer l'ensemble second étage vide, case à
équipement, troisième étage et le satellite par un jeu de micro tuyère
alimentées en fréon de manière à lui donner une direction parallèle à l'horizontale de l'apogée de la trajectoire balistique intermédiaire.
L'ensemble est mis en rotation à 5 tours par seconde afin de donner à l'axe
une direction fixe dans l'espace et stabilisé par effet
gyroscopique.
Le troisième étage est séparée de la case à
équipement. Il est mis à feu et achève de communiquer la vitesse de
satellisation au satellite.
Un peu plus de 8 mn après le lancement, le
troisième étage vide et le satellite sont sur
orbite.
|
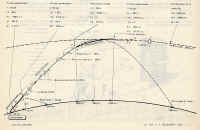 |
La mise sur orbite d'un
satellite à l'aide de Diamant s'effectue selon la procédure
suivante
- Mise à feu du générateur de
pressurisation du 1er étage. Environ 3 secondes après, largage de la
sangle liant l'engin à la table de lancement (délai d'établissement
de la pleine poussée).
- Propulsion du 1er étage pendant 93
secondes environ Le lanceur est piloté durant la propulsion des deux
premiers étages de façon à suivre un programme d'assiette " mis en
mémoire dans un programmeur d'attitude".
- Séparation 1er - 2eme
étage pendant la décroissance de la poussée du 1er étage. La
détection de la chute de poussée est faite par un accéléromètre
réglé à 1,6 g. Une seconde après la détection, il y a mise à feu de
12 vérins pyrotechniques qui assurent le déverrouillage et la
séparation des deux étages. |
|
- Allumage du
2eme étage une demi seconde après la mise à feu des vérins de
séparation. La combustion du 2eme étage dure 44 secondes environ. Un
accéléromètre détecte la queue de poussée et le dispositif
auxiliaire de pilotage prend en charge l'ensemble 2eme étage vide -
3ème étage " qui est basculé lentement autour de son centre de
gravité. Ce dernier suit alors une trajectoire balistique dont
l'apogée a une altitude voisine de celle du périgée escompté de
l'orbite. Le basculement dure environ 2 minutes et oriente engin
selon une direction sensiblement parallèle à l'horizontale locale du
point qui sera atteint au moment de l'allumage du 3eme étage.
-
La coiffe qui protégeait le satellite pendant la traversée des
couches denses de l'atmosphère est éjectée dix secondes environ
après la fin de combustion du 2eme étage.
- L'engin,
convenablement orienté, est mis ensuite an rotation autour de son
axe de roulis à 270 t-mm., en 1 seconde environ, à l'aide de quatre
petites fusées à poudre montées sur la case à équipements.
-
Séparation du 2eme étage vide par déverrouillage (14 secondes
environ après la fin de la mise en rotation) des deux demi coquilles
constituant la jupe avant largage et allumage des deux rétrofusées
montées sur la case équipements.
- Allumage du 3eme étage
lorsqu'il atteint le voisinage de l'apogée de la trajectoire
balistique intermédiaire suivie par l'engin depuis l'extinction du
2eme étage. L'instant d'allumage est donné par le programmeur de
séquences de l'engin, à un temps prédéterminé fonction de l'orbite
nominale, mas un recalage de cet instant nominal est possible par
télécommande grâce à un calculateur au sol. Il est effectué par
télécommande à partir des éléments d'une trajectographie réalisée
pendant les premières secondes du vol balistique
intermédiaire.
Combustion du 3eme étage pendant 45 secondes
environ.
- Extinction du 3eme étage et début de la mise en
orbite au périgée théorique.
|
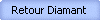
|
CHRONOLOGIE DE
LANCEMENT
La chronologie d un tir de Diamant "
telle que résumé ci-après, repose évidemment sur des bases
théoriques la réalité correspond rarement aux prévisions, surtout
pour un engin aussi complexe qu'une fusée à trois étages, faisant de
surcroît appel à un moteur bi liquides. Mais cette chronologie
théorique permet de mieux comprendre les précautions extraordinaires
prises par les techniciens pour réduire les risques d'échec tout est
contrôlé, manuellement et automatiquement, dans les moindres
détails, ce qui nécessite d'ailleurs un énorme appareillage
électronique dont la seule mise au point est déjà, en elle-même, une
lourde tâche. Comme la fusée elle-même, cet appareillage était
transporté au Sahara en double exemplaire, afin de réduire les
risques de pannes. Quant aux moyens du champ de tir, ils sont, eux
aussi, contrôlés avec sévérité et leur mise en oeuvre exige un
millier de personnes... sans oublier les stations de poursuite et de
télémesure réparties sur deux continents et qui doivent rester en
alerte. La mise sur orbite d'un satellite est donc une opération
très complexe, infiniment plus que le premier vol d'un
avion.
le compte à rebours
H - 6 h
30
- Premier départ des équipes des constructeurs et du
Centre d'Essais vers la base de lancement (" Brigitte ").
H
- 6 h 00
- Mise en place du personnel et du matériel pour
le remplissage en " fantol " et le remplissage en essence du premier
étage.
- Déhaubannage de la fusée: réchauffage de la
batterie S.B. 8.
- Début du remplissage en fantol (celui-ci
demande cinq minutes).
H - 5 h 45
- Fin de
remplissage " fantol " et début de remplissage en essence de
térébenthine (15 minutes)
H - 5 h 00
- Fin de
remplissage essence mise en place sécurité incendie et équipe
sanitaire côté acide mise en place de l'avitailleur acide. H - 4 h
15
- Évacuation de la rampe par le personnel non
indispensable; début de remplissage en acide nitrique contrôle de
l'allumeur de la charge de destruction du premier étage.
H
- 3 h 45 - Mis e en place du personnel pour l'essai général du champ
de tir début d'écoute (bases " Bacchus ", Brétigny,
Guépratte).
H - 3 h 30
- Essai Général Champ de
Tir (chronologie fictive prise à H - 15'). Cet essai se poursuit en
temps réel au moins jusqu'à H + 12'. Il se poursuit, si nécessaire,
en temps accéléré.
H - .3 H 00
- Fin de
remplissage acide.
- Coupure du réchauffage batterie S.B.
8.
- Début de l'armement pyrotechnique (deuxième phase) la
clef du pupitre de tir est remise aux artificiers branchements
pyrotechniques des premier et deuxième étages de la
fusée.
H - 1 h 45
- Repli provisoire des
artificiers mise sous tension manuelle du fonctionnel pilotage, et
mise en route de la centrale d'attitude S.A.G.E.M.
H - 1 h
35
- Suite armement pyrotechnique (deuxième phase) la
centrale S.A.G.E.M. et les ventilations restent en route début de
l'étalonnage de la télémesure.
H - 1 h 10
-
Remplacement de l'enceinte chauffante troisième étage par une housse
calorifuge largable.
H - 50'
- Évacuation de
l'engin par les artificiers ; retrait du portique et contrôle de la
centrale S.A. G.E.M.
H - 20'-- Arrêt de la ventilation du
bloc S.A.T. premier étage. Le personnel de la tour se
replie.
H - 15'- Fermeture des portes du P.C. "
Brigitte" ; remise de la clef du pupitre à l'opérateur pupitre
de tir ; fin de l'étalonnage de la télémesure.
H - 12'-
Feu vert PC. " Brigitte " ; remise hautes tensions radar et
télécommande.
C'est la séquence de mise en oeuvre et de
surveillance de l'engin uniquement faite depuis le P.C. de lancement
par le pupitre de tir. Elle commence à H - 10'; à partir de ce
moment aucun personnel ne doit se trouver sur l'aire de lancement.
Les contrôles automatiques suivants sont effectués
H - 10'-
Établissement du contact général du pupitre de tir ; contrôle des
voyants ; démarrage de la caméra du pupitre et des contrôleurs qui
effectuent leur autocontrôle.
H - 9'- Alimentation de
l'engin sur les batteries externes (en particulier répondeur, balise
C.N.E.T., télémesures, qui émettent quelques secondes après)
contrôle de l'alimentation fonctionnelle pilotage premier étage;
début des contrôles télémesures et contrôle de répondeur.
H
- 8'- " Brigitte " cesse d'interroger l'engin et contrôle sa réponse
à l'interrogation de radar Aquitaine.
H - 5'- Les
récepteurs de télécommande sont branchés sur une alimentation
extérieure ; Vérification du passage des ordres de démarrage
troisième étage et de l'ordre de destruction contrôles des tensions
de télécommandes et de l'électronique de basculement.
H - 4'- Mise en route des enregistreurs magnétiques.
H - 3'20" -
Coupure de l'alimentation extérieure télécommande. Contrôle de la
chaîne de pilotage du premier étage.
H - 2'30" - Le point
de télémesure passe le vert si tout est correct.
H - 2'-
Ouverture des vannes haute pression et basse pression du premier
étage contrôle dynamique de la chaîne de pilotage du premier
étage.
H - 1'15" - Armement des moteurs allumeurs du
premier et du deuxième étages suite des contrôles premier étage et
télémesure.
H - 1'- Branchement de l'engin sur batterie
interne démarrage du G.A.P. du deuxième étage et changement de
vitesse de la caméra du pupitre contrôles du pilotage du deuxième
étage.
H - 20" - Armement du dispositif de destruction.
Démarrage de l'enregistreur derniers instants ".
H - 10" - Mise
en route des caméras oscilloscopes.
H - 7" - Mise en route
de l'horloge du pupitre du tir qui, à partir de cet instant,
commande automatiquement les séquences. Démarrage du programme de
séquences (case d'équipement) et du programmeur de séquences
d'attitude ; Armement, largage sangle ; Branchement des batteries
pyrotechniques de l'engin.
H - 5" - Déclenchement des
caméras et de tous les enregistrement sol.
H - 2" - Largage
des prises ombilicales " charges utile " et " case d'équipement ".
Ce largage conditionne la mise à feu des fusées
anti-roulis.
H - O - Ordre " FEU " du pupitre de tir ; il
déclenche - la mise à feu du générateur du 1er étage. - le largage de
la prise ombilicale du 1er étage.
Remarque : Durant toute la
séquence de tir, il est possible de faire un arrêt de chronologie et
de revenir en arrière si cela est nécessaire.
Le décompte " positif
:
On suppose ci-dessous que l'engin a
décollé 3 sec. après l'ordre " FEU " de l'officier de tir, prononcé
en lisant H = -O au décompte. Les temps ci-dessous énoncés sont les
temps lus sur les voyants du décompte, qui mettent 1 seconde à
passer de -0 à + 0.
H + 2" - Décollage. Il est contrôlé par
l'opérateur Centre d'Essai du P.C.C.T. qui annonce alors " TOP
DÉCOLLAGE " (l'allumage de la tuyère n'est pas significatif, il a
lieu environ 1,5 à 2'avant le décollage).
H + 7" - Largage
fusée anti-roulis.
H + 1'35" - Fin de propulsion 1er étage
mise à feu 2eme étage.
H + 2'19" - Fin de propulsion 2ème
étage.
H + 2'32" - Largage coiffe. - Déploiement des
antennes 2'38".
H + 2'47" - Début de
basculement.
H + 4'45" - Mise en rotation.
H + 4'59" - Séparation 3ème étage.
H + 6'32" - Retombée de l'étage.
H + 7'20" - Mise à feu 3ème étage.
H + 8'5" - Fin de propulsion 3ème étage injection périgée
H + 10'22''- Séparation satellite du 3ème étage.
H + 14'04" -
Retombée du 2ème
étage. |
Diamant A fait son entré dans le club très fermé des
puissances spatiales le 26 novembre 1965 à 15 h 47 mn 21 s (heure de
Paris) en plaçant sur orbite le premier satellite Français A1 Astérix.
Trois autres Diamants seront lancés de la base algérienne d'Hammaguir
jusqu'en février 1967 avant sa fermeture en
juillet de la même année.
|
26 novembre 1965 15h 47 mn 21 s
|
Hammaguir |
A1 Astérix 39 kg |
528/ 1787 km |
|
17 février 1966 8 h 33 mn 36 s |
Hammaguir |
D 1 Diapason 18,5 kg |
506/ 2750 km |
|
8 février 1967 |
Hammaguir |
D1 C Diadème 23 kg |
572/ 1353 km |
|
15 février 1967 |
Hammaguir |
D1 D Diadème 2 23 kg |
592/ 1868 km |
|